
Myélofibrose: «Ce n’est qu’avec le temps qu’on devient experte de sa propre maladie.»
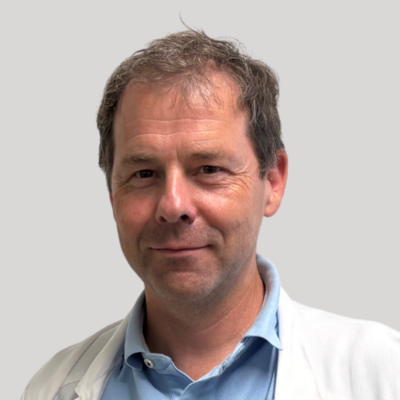
Depuis 2019, Esther vit avec une myélofibrose, sans pour autant se laisser définir par la maladie. Le mouvement, son jardin, la montagne et les échanges avec d’autres personnes dans son cas lui donnent de la force.
Le Dr Thomas Lehmann, hématologue, explique pourquoi le diagnostic est souvent long à établir et quelles options thérapeutiques existent aujourd’hui.
Esther, en 2019, vous avez reçu le diagnostic de myélofibrose. Quels symptômes aviez-vous alors?
Esther: Avec le recul, ce fut un long chemin. Beaucoup de mes troubles appartenaient peut-être déjà à la maladie, mais je ne pouvais pas les y relier. Je souffrais souvent d’épuisement, j’avais régulièrement un peu de fièvre, mais aussi, pendant plus de vingt ans, j’ai eu des bronchites et des inflammations intestinales récurrentes. S’y ajoutaient de fortes migraines. À 50 ans, des sueurs nocturnes extrêmes sont apparues, si intenses que je savais que ce n’étaient pas les symptômes de la ménopause. Plus tard, j’ai eu une thrombose des sinus veineux. Après une ponction de moelle osseuse et un test génétique, le diagnostic a d’abord été: thrombocytose essentielle. En 2019, j’ai perdu beaucoup de poids et une nouvelle ponction a confirmé le passage à une myélofibrose.
Dr Lehmann, pourquoi la myélofibrose n’a-t-elle pas été reconnue dès la première investigation?
Dr Thomas Lehmann: Ce n’est pas rare. Certaines patientes développent d’abord ce qu’on appelle une «thrombocytose essentielle» ou une «polyglobulie vraie». Ces maladies peuvent évoluer, au fil du temps, vers une myélofibrose.
Les symptômes décrits par Esther sont-ils typiques?
Lehmann: La réalité est qu’il n’y a pas de symptômes vraiment typiques. Le plus souvent, on observe des plaintes non spécifiques comme la fatigue, des troubles de concentration, des sueurs nocturnes, de la fièvre ou des douleurs osseuses. Un signe relativement clair est une rate dont le volume augmente. Justement parce que les symptômes sont si peu spécifiques, le diagnostic prend souvent des années. Beaucoup de patients traversent un long «parcours» de consultations avant que la maladie ne soit identifiée.
Comment diagnostique-t-on la myélofibrose?
Lehmann: Déjà, les analyses sanguines peuvent éveiller un premier soupçon. On y voit des modifications caractéristiques, et on peut aussi détecter des mutations génétiques dans le sang périphérique. La ponction de moelle osseuse confirme le diagnostic et permet de classer la maladie dans un sous-type précis.

L’oncologue Dr Thomas Lehmann accompagne Esther depuis de nombreuses années.
Et ensuite, quel traitement avez-vous reçu?
Esther: Mon premier diagnostic, la thrombocytose essentielle, a été suivi d’un traitement par un ancien chimiothérapeutique en comprimés. L’effet secondaire principal était une sensation désagréable de piqûres sur la peau, comme mille aiguilles. Plus tard, j’ai changé de médicament, ce qui m’a affectée psychiquement. Le traitement par un inhibiteur de JAK a marqué un véritable changement de paradigme. Mon énergie est revenue. J’ai pu, petit à petit, retrouver mon quotidien. Ce qui m’aide aussi, c’est la médecine complémentaire.
Dr Lehmann, quelles options de traitement existent aujourd’hui pour les patientes atteintes de myélofibrose – en première ligne, comme lors d’une rechute?
Lehmann: Plus les symptômes sont marqués, plus tôt nous introduisons un inhibiteur de JAK. Celui-ci agit très rapidement: les troubles disparaissent, l’énergie revient, la qualité de vie s’améliore nettement. Esther a ainsi pu reprendre l’enseignement et retravailler à temps partiel.
Guérir la myélofibrose n’est actuellement pas possible, sauf en effectuant une greffe de cellules souches. Mais celle-ci n’est indiquée qu’à un stade avancé, car elle comporte des risques considérables. Le traitement médicamenteux est poursuivi tant qu’il reste efficace. Certains patients développent toutefois des résistances.
Justement, les résistances: on essaie de les retarder le plus possible. Que se passe-t-il dans la recherche?
Lehmann: Pour l’avenir, nous espérons des thérapies combinées qui empêchent ou retardent le développement de résistances, ainsi que des approches qui stabilisent suffisamment la moelle osseuse pour permettre une réduction du traitement. Notre grand rêve reste une thérapie qui puisse réellement inverser la myélofibrose. Malheureusement, nous n’en sommes pas encore là.
Comment allez-vous aujourd’hui, Esther?
Esther: Je vis avec ma maladie, mais elle ne détermine pas mon quotidien. Avec le nouveau médicament, je vais beaucoup mieux, même s’il y a toujours des hauts et des bas physiques. Il y a tant de choses dans ma vie qui me réjouissent: mon jardin, la montagne, les événements culturels ou actuellement la cueillette de champignons. Le positif l’emporte. J’ai appris à mieux connaître mes limites et à demander de l’aide lorsque j’en ai besoin. Les échanges avec d’autres personnes concernées me sont également d’une grande richesse.

Dans la nature et lors d’excursions, Esther peut refaire le plein d’énergie.
Comment vous êtes-vous informée sur la maladie et où avez-vous trouvé du soutien?
Esther: Au début, j’ai cherché sur Internet et j’ai été assez effrayée par les informations que je trouvais sur le pronostic: je suis tombée sur une espérance de vie moyenne de sept ans et là, je me suis dit: «Oups, il faut que je me dépêche.» Heureusement, j’ai découvert le réseau allemand MPN, puis le réseau suisse MPN. Nous nous rencontrons régulièrement, nous nous appelons au besoin et partageons nos expériences. Ces échanges avec d’autres malades sont incroyablement précieux: nous rions beaucoup, mais nous parlons aussi ouvertement de la mort et de la finitude. Mon objectif est d’accepter la maladie de manière positive.
Dr Lehmann, quelles questions aimeriez-vous que vos patients posent?
Lehmann: Je suis particulièrement soucieux des questions qui préoccupent vraiment les patientes. Souvent, il s’agit aussi de comprendre ce qui, dans ce que j’explique, est réellement perçu. Un diagnostic tombe souvent comme un coup de massue, et il faut du temps pour digérer les informations. Certaines veulent tout savoir dans les moindres détails, d’autres préfèrent se limiter à l’essentiel. Il est donc primordial d’avoir le sens du moment et de savoir quelles informations sont appropriées à quel stade.
Il est aussi important de parler de la finitude et de la mortalité, bien sûr, en fonction de la situation. Chez les patients plus jeunes, un diagnostic de myélofibrose signifie que l’espérance de vie est réduite. Les pronostics sont difficiles, car la fourchette est large – en moyenne de cinq à quinze ans, parfois jusqu’à vingt.
Je vis avec ma maladie, mais elle ne détermine pas mon quotidien.
Esther, auriez-vous été capable de prendre une décision lors du choc initial?
Esther: Lors de ma première consultation, on m’a simplement annoncé quel médicament allait m’être prescrit; aucune alternative n’a été discutée. Je n’aurais de toute façon pas pu décider à l’époque, je n’avais aucune connaissance. Ce n’est qu’avec le temps qu’on devient experte de sa propre maladie et qu’on peut participer activement aux choix. Au début, on veut surtout des réponses à ses questions et que le médecin prenne le temps de les donner.
Quels conseils donnez-vous aux patients pour faire face à cette charge?
Lehmann: Je compare volontiers la myélofibrose à un sac à dos qu’on ne peut jamais poser. Il y a des phases où il est à peine perceptible, et d’autres où il est très lourd. L’essentiel est de savourer consciemment les bons moments. Rester actif, bouger et faire du sport, tout cela peut aider. Et, pas à pas, reconquérir l’espace que la maladie restreint.
Esther: Exactement, j’essaie aussi de me concentrer sur les belles choses et de me ressaisir, même si parfois je préférerais rester allongée sur le canapé. Le mouvement me fait du bien, ainsi que les échanges avec d’autres malades et les moments avec les amies. Et il ne faut pas hésiter à demander de l’aide.
Date: 09.10.2025
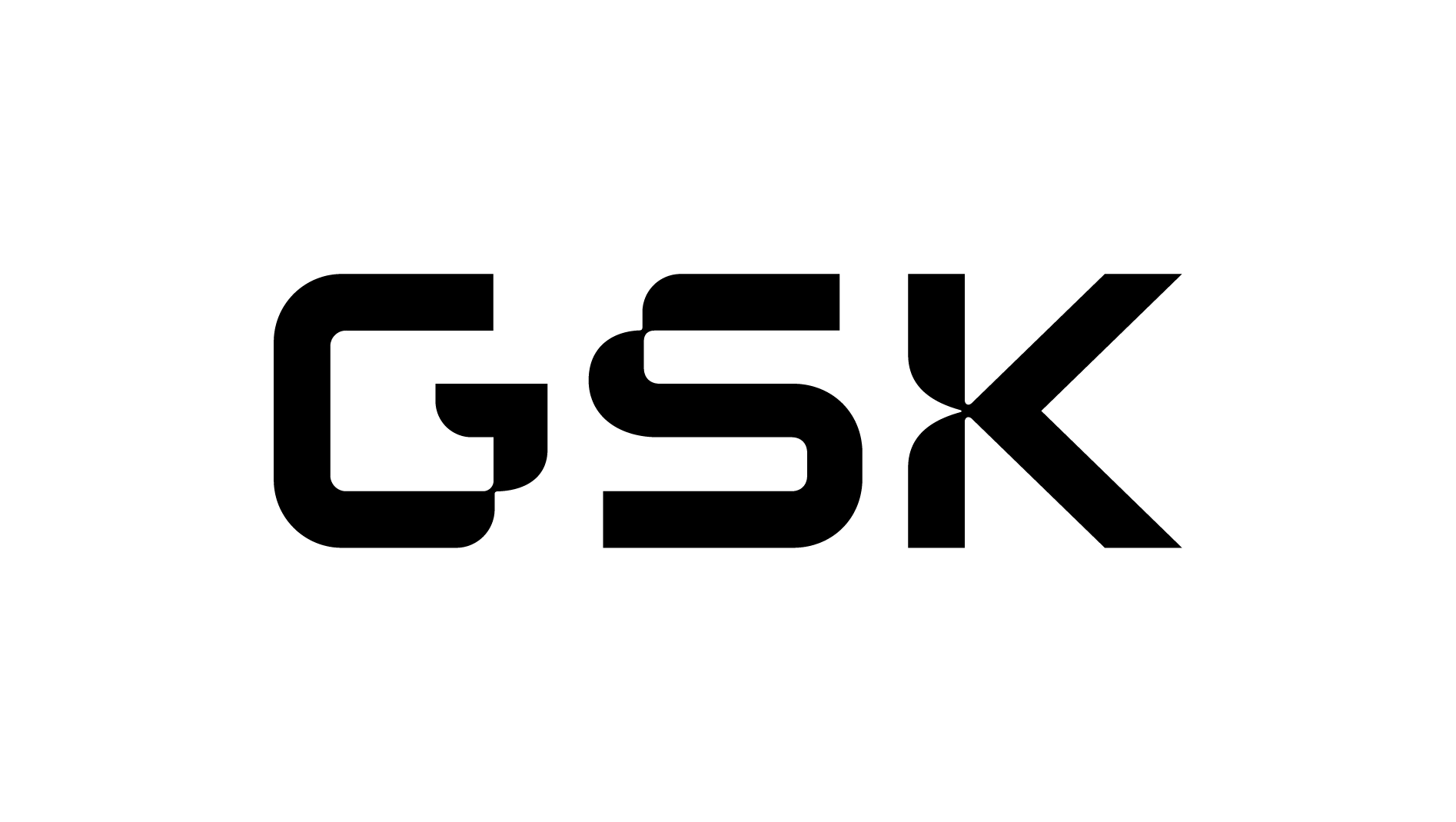
GSK est une entreprise active dans la recherche à l’échelle mondiale avec comme objectif d’améliorer la qualité de vie des personnes. Notre travail en oncologie est axé sur l’optimisation de la survie des patients grâce à des médicaments innovants. Nous nous engageons pour les personnes atteintes d’un cancer.